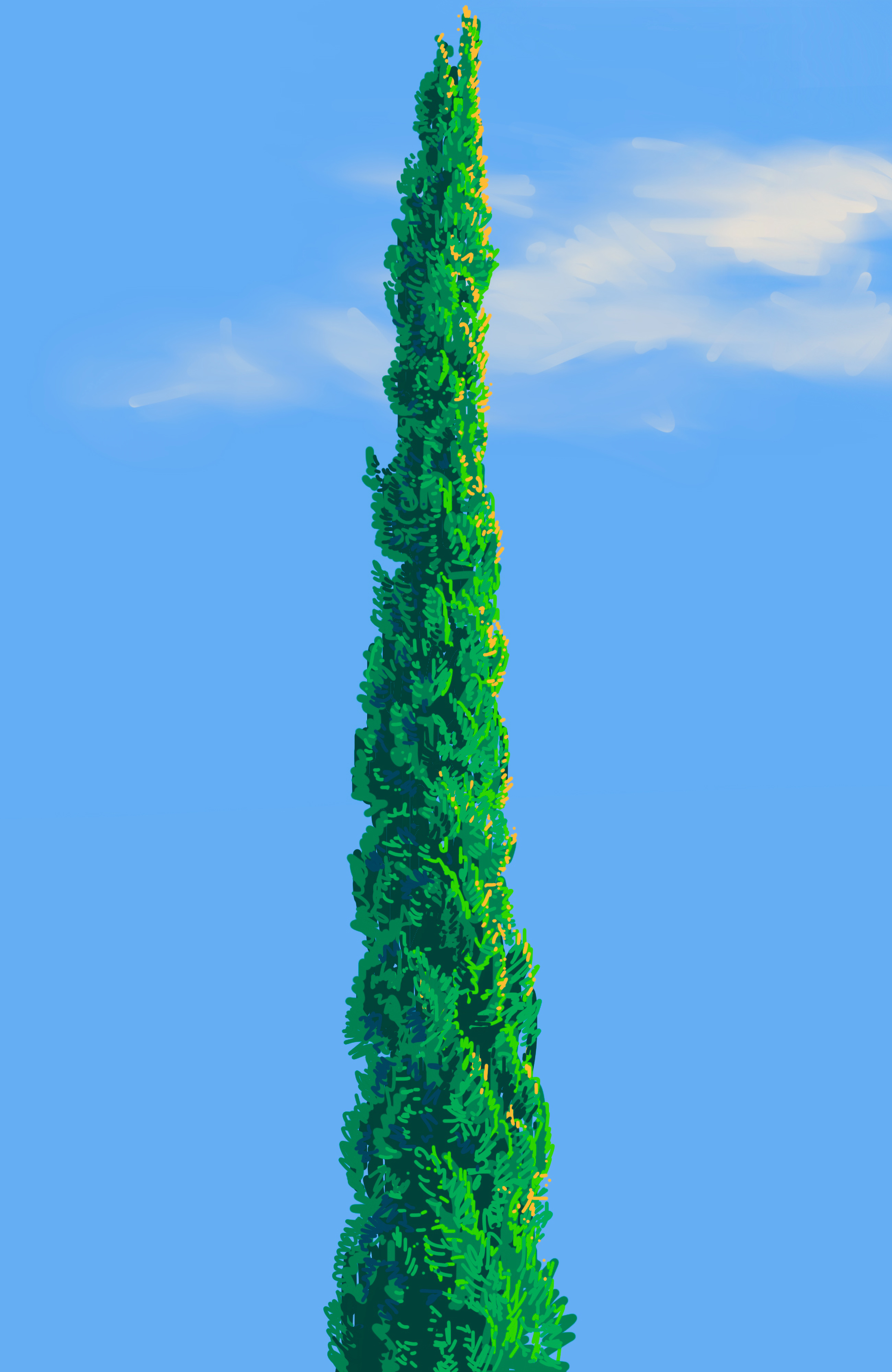
Louise Sartor, De haut en bas & back again
juillet 4-septembre 19, 2025 – Monaco
Commissariat : Oriane Durand
L’exposition personnelle de Louise Sartor à La Società delle Api réunit une série de peintures et de dessins réalisés au cours des trois dernières saisons au Moulin des Ribes, à Grasse. Exécutées sur carton ou sous forme de dessins digitaux, les œuvres déclinent principalement le motif du cyprès et celui du bouquet de fleurs fanées. Derrière ces représentations d’apparence réaliste, empruntant à une facture classique, le choix du support, tout comme la mise en regard de deux états du végétal – l’un persistant, l’autre en déclin – articulent une réflexion plus large sur les temporalités du vivant, les cycles de transformation et les modes d’apparition des images.
Le choix du carton comme support pictural est un point d’entrée essentiel dans l’économie du travail de Louise Sartor. Matériau pauvre issu de la chaîne de consommation, il traduit un positionnement esthétique et politique : peindre sur carton, c’est refuser la hiérarchie matérielle traditionnelle – celle qui fait de la toile le matériau noble par excellence – tout en assumant une forme de proximité avec l’ordinaire et le quotidien. Le carton introduit dans le champ de la peinture une instabilité, une précarité, une forme de familiarité. Il renvoie à un matériau dit « banal », aux logiques de circulation et d’échange, mais aussi à la possibilité de produire avec des moyens accessibles, disponibles partout et à tout moment. Les morceaux de carton sur lesquels l’artiste peint ne sont en réalité pas si « simples ». Chacun possède une forme spécifique, souvent asymétrique, parfois déchirée, toujours singulière et en définitive unique pour un tableau. Ce geste, ce renversement, proche en cela des stratégies d’artistes tels que Thomas Hirschhorn ou de Richard Tuttle qui utilisent le carton comme support fragile et à a priori sans valeur, ouvre un espace critique posant les questions suivantes : que produit-on quand on peint ? Qu’est-ce qui est valorisé ? Pour représenter quoi et sur quel support ?
Démultiplié sur des morceaux de carton délibérément choisis, le motif du cyprès introduit lui aussi une autre forme de renversement. Il opère d’abord sur le plan symbolique. Arbre méditerranéen par excellence, souvent associé aux cimetières et à la figure du deuil, le cyprès est aussi un végétal persistant, emblème d’immortalité et de longévité, grâce à son feuillage toujours vert. Van Gogh, qui en fit de nombreuses représentations, le décrivait comme un arbre qui « relie le ciel et la terre ». Cette dimension cosmique se manifeste pleinement dans Nuit étoilée à Saint-Rémy (1888), où le cyprès surgit de l’obscurité tel une flamme sombre sur laquelle les étoiles semblent s’accrocher. Dans la série de Louise Sartor, la réitération presque obsessionnelle du motif, associée à une rigueur formelle dans sa verticalité, produit une impression d’élan, de mouvement ascendant qui semble défier l’entropie. D’une peinture à l’autre, ce n’est pas l’arbre qui change, mais son environnement : le ciel, la lumière ou encore le feuillage alentour. Cette variation minimale révèle une forme de vitalité continue, qui finit par transcender le support modeste sur lequel elle se déploie.
Face à cette dynamique ascensionnelle, apparemment plus solide que le temps qui passe, la série de fleurs fanées se distingue par une atmosphère paisible et silencieuse, presque pieuse. Inscrites dans la tradition des natures mortes, ces vanités évoquent la finitude de l’existence, la fugacité des plaisirs terrestres et l’inutilité des biens matériels face à la mort. La fleur, ici saisie dans sa phase terminale, apparaît comme une forme intérieure, pelotonnée sur elle-même. Et pourtant, l’artiste insuffle à ce sujet une forme de vie singulière. Ces bouquets, dont la verticalité fragile est maintenue par des récipients discrets, dégagent une présence subtile mais indéniable. La précision du geste pictural donne à percevoir le moment de bascule, cet intervalle entre l’éclat du vivant et la disparition. Les tiges, fines mais ténues, sont représentées par des lignes presque nerveuses qui expriment malgré tout une forme d’énergie résiduelle. Les feuilles, quant à elles, ondulent comme de petits serpentins. Figures d’une mémoire du mouvement, elles prolongent l’élan vital dans un ultime ballet.
S’il y a d’un côté une force ascendante, persistante, liée à la forme et à la répétions du motif de cyprès et de l’autre, un mouvement descendant, intime, orienté vers l’intérieur et l’éphémère, le titre De haut en bas et back again propose une lecture cyclique, non linéaire, de cette relation. Il s’agit moins d’un affrontement que d’une dialectique dans laquelle l’un ne va pas sans l’autre. La vie et la mort ne sont pas exposées comme des opposés, mais comme des états co-présents, imbriqués, qui se rejouent dans l’acte même de peindre.
À ce niveau, la pratique de Louise Sartor engage aussi une réflexion sur le statut de l’image et sa reproductibilité. Le recours à la sérialité, que ce soit dans les sujets représentés ou dans les formats, inscrit son travail dans une tradition qui va de Warhol aux artistes conceptuels des années 1970. Le titre de l’exposition fait d’ailleurs précisément référence au livre d’Andy Warhol From A to B and back again (1975), où l’itération devient un mode de pensée. Ici, la répétition n’est pas redondance, mais un acte pop de variation : elle permet de déplacer l’attention, de creuser l’écart, de mettre à jour des différences fines. Elle inscrit les œuvres dans un espace de temporalité élargie, où chaque image est un moment dans un processus, plutôt qu’un objet fini.
En contrepoint aux œuvres sur carton, une série de dessins digitaux vient élargir le champ de la réflexion. Présentées sur écran plat, ces dessins ont été assemblés sous la forme d’un diaporama qui tisse un récit à la fois personnel et imaginaire. On y retrouve le motif du cyprès intégré à une constellation d’œuvres plus anciennes, brouillant la chronologie de leur apparition. Le recours au médium numérique prolonge ainsi la question de la circulation, de la reproductibilité et de l’instabilité des images. Ces dessins répondent aux logiques propres du digital, comme la juxtaposition de fragments narratifs, la coexistence de temporalités disjointes et la superposition de strates visuelles. La peinture devient alors un espace poreux, traversé par une pluralité de régimes d’images, qui ne relèvent plus uniquement de la tradition picturale, mais de l’écologie visuelle contemporaine et industrielle. Même sur carton, l’image peinte s’inscrit dans ce réseau, s’y confronte ou y résiste.
Ce qui reste central dans le travail de Louise Sartor est la persistance d’un regard qui se tourne vers des formes élémentaires – un arbre, une fleur, un vase – non pas pour en extraire une essence, mais pour en rejouer la présence dans des conditions matérielles et symboliques contemporaines. L’acte de peindre devient alors un geste de mesure : mesurer la distance entre les choses, entre les images, entre les états du vivant. C’est aussi une manière de penser la durée, le passage et la transformation. De haut en bas et back again n’est pas seulement un titre, c’est une méthode. Une manière de traverser les formes, de faire retour, de maintenir une tension active entre élévation et chute, persistance et effacement. L’exposition ne cherche pas à produire un discours univoque ou spectaculaire, mais à ouvrir un espace de perception, de lecture lente, où chaque œuvre agit comme un point d’inflexion. Entre rigueur formelle et attention sensible, entre économie de moyens et densité symbolique, le travail de Louise Sartor interroge ce qui fait image, aujourd’hui.
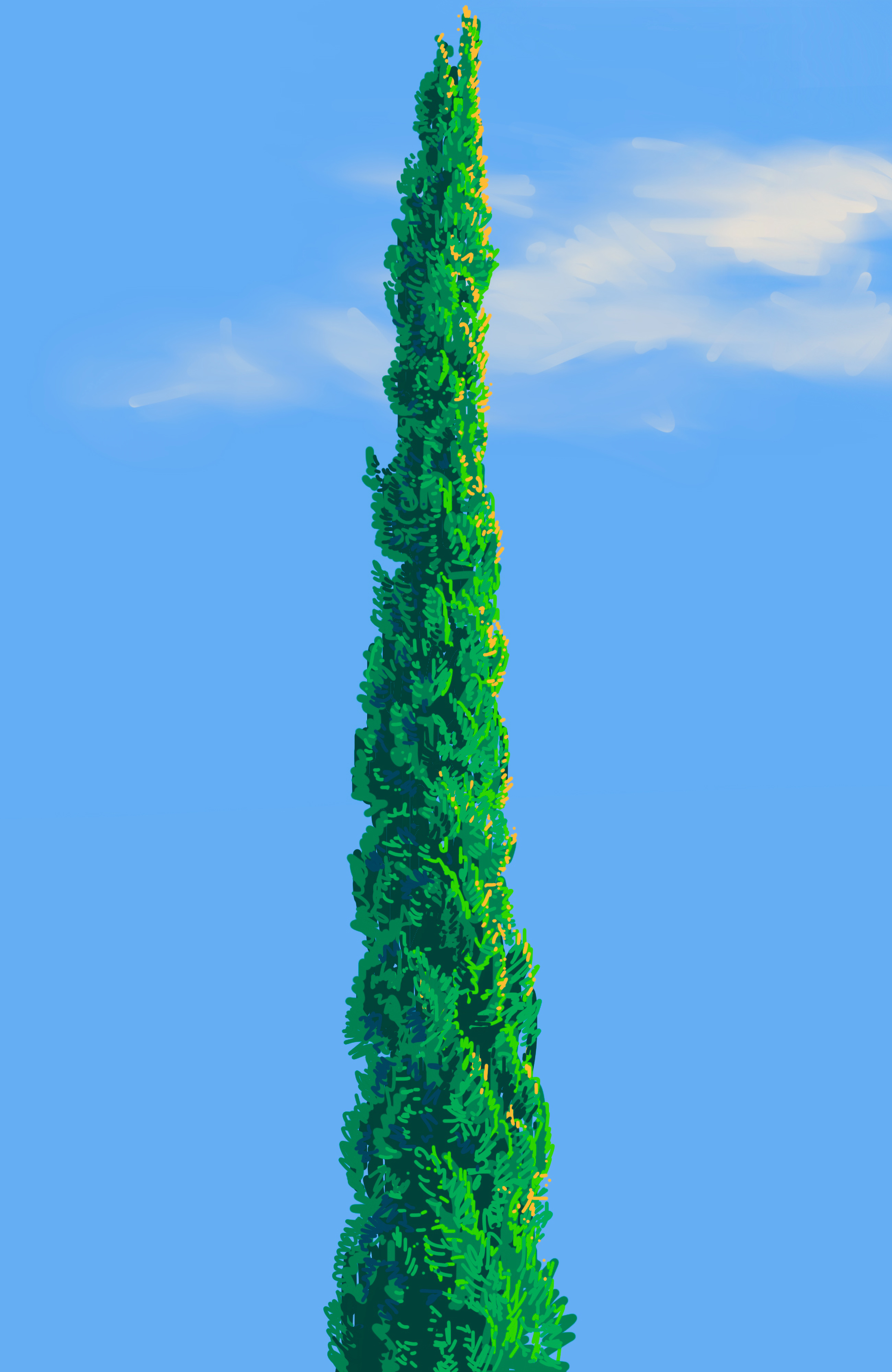
NOTES BIOGRAPHIQUES
Louise Sartor vit et travaille à Paris où elle est née en 1988. Elle a récemment exposé à la galerie Crèvecoeur à Paris (FR), Page à New-York (US), Bel-Ami à Los Angeles (US), aux centres d’art la Synagogue de Delme (FR), Treignac Projet (FR), le Consortium de Dijon (FR), MO.CO. Panacée de Montpellier (FR), aux musées Jean Honoré Fragonard de Grasse (FR), Picasso Màlaga (ES), MASC des Sables d’Olonne (FR), Mucem de Marseille (FR), X-Museum de Beijing (CN) ,l’Institut Français de Tokyo (JP)… Elle a été pensionnaire de la Villa Medici en 2019-2020 et son travail fait partie des collections du Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, du Musée d’art moderne et contemporain de Genève (CH), et des FRAC Poitou-Charentes, Bourgogne et Corse.
Oriane Durand est commissaire d’exposition et auteure, basée à Berlin. Elle a étudié l’histoire de l’art à la Sorbonne (Paris) et à la Freie Universität (Berlin). De 2015 à 2020, elle a dirigé le Kunstverein de Dortmund, puis assuré la direction du Kunstverein de Bielefeld en 2023. Auparavant, elle a été curatrice au Kunstverein de Nuremberg et au Kunstverein de Bonn. Portée par un intérêt particulier pour la découverte de jeunes artistes et les pratiques expérimentales, elle a notamment organisé les premières expositions institutionnelles en Allemagne d’artistes tels que Raphaela Vogel (Bonner Kunstverein, 2015), Sol Calero (Dortmunder Kunstverein, 2017), Elaine Cameron-Weir (Dortmunder Kunstverein, 2018), Mimosa Echard (Dortmunder Kunstverein, 2019), Sara Sadik (Westfälischer Kunstverein, 2022) et Tolia Astakhishvili (Kunstverein Bielefeld, 2023). Elle écrit régulièrement pour la presse spécialisée internationale (Frieze, CFA…) ainsi que pour des catalogues d’artistes.